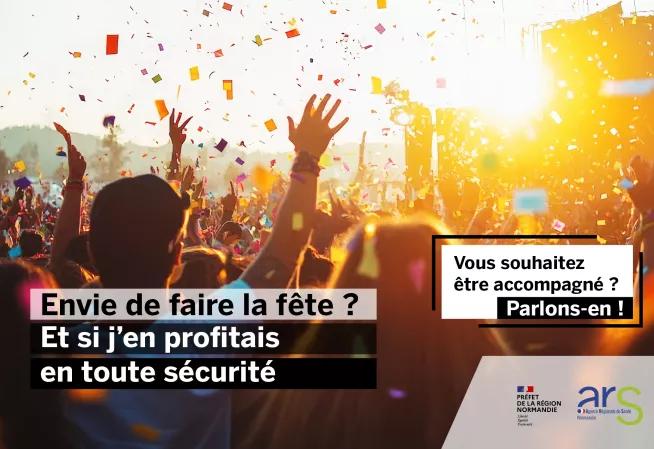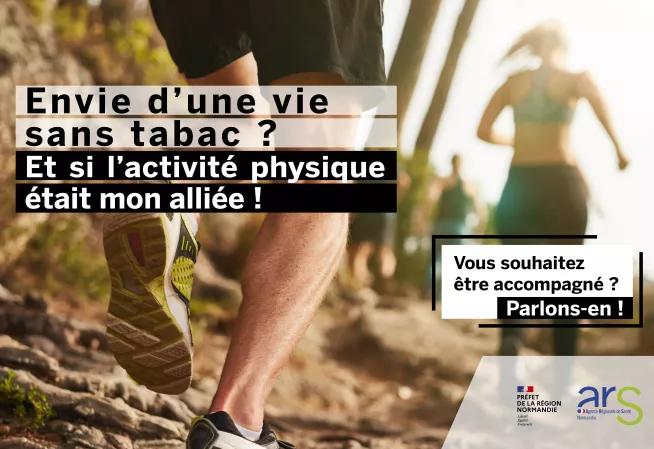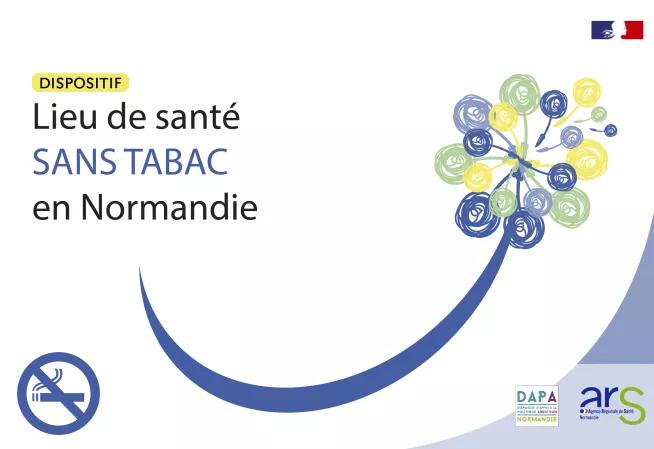En 2021, selon une étude de Santé Publique France, en Normandie, 7,8 % des adultes de 18-75 ans ont déclaré consommer de l’alcool quotidiennement et 16,1% des adultes de 18-75 ans ont déclaré avoir des alcoolisations ponctuelles importantes en l'espace d'un mois.
La consommation d’alcool représente un enjeu de santé publique majeur en France, où elle est à l’origine de 49 000 décès par an. Il en est de même en Europe, où elle est responsable de plus de 7 % des maladies et décès prématurés. Des millions de personnes présentent une consommation d’alcool à risque, voire une situation d’alcoolodépendance.
En Normandie, des dispositifs vous sont proposés pour vous aider ou aider l'un de vos proches qui serait en difficulté face à l'alcool.
La consommation d'alcool comporte toujours des risques pour la santé, qui augmentent avec la quantité consommée au fil du temps.
Afin de définir des seuils de risques acceptables, un groupe d'experts mandaté par Santé publique France et l’INCa a proposé des repères communs pour les deux sexes :
pas plus de 10 verres standard par semaine ;
pas plus de 2 verres standard par jour ;
prévoir des jours sans alcool chaque semaine.
Les experts recommandent également de limiter les risques lors de la consommation en :
réduisant la quantité d'alcool bue à chaque occasion ;
buvant lentement, en mangeant et en alternant avec de l'eau ;
évitant les lieux ou activités à risque ;
restant en compagnie de personnes de confiance et en prévoyant un retour en toute sécurité.
Ces recommandations peuvent être résumées ainsi :
« Pour votre santé, l’alcool, c’est MAXIMUM 2 VERRES PAR JOUR ET PAS TOUS LES JOURS. »
Dans certaines situations, la meilleure option est de ne pas consommer d'alcool, notamment :
- pendant la grossesse et l’allaitement (cliquez-ici pour consulter la campagne dédiée à la thématique de l'alcool pendant la grossesse) ;
- pendant l’enfance, l’adolescence et la toute la durée de la croissance ;
- lors de la conduite automobile ;
- lors de la pratique de sports à risque ;
- en cas de prise de certains médicaments ;
- en cas de certaines maladies.
Pour mémoire, un « verre standard » correspond à 10 grammes d’alcool pur, quelle que soit la boisson alcoolisée (vin, bière ou spiritueux).
S'autoévaluer
Afin de prévenir les risques de consommation d'alcool pour la santé, il est important de pouvoir repérer, informer et aider les personnes ayant une consommation dite à risque. Ainsi, l'outil Alcoomètre permet de s'auto-évaluer et peut être également proposé aux patients.
Se référer à un professionnel de santé
Les médecins généralistes, ainsi que les professionnels de santé de premier recours (sages femmes, gynécologues obstétriciens, pharmaciens…), sont les acteurs privilégiés du repérage des problèmes d’alcool.
En identifiant ces patients et en réalisant, si nécessaire, une intervention brève, les professionnels de santé ont l’opportunité de les sensibiliser aux risques associés à leur consommation d’alcool. Ce programme de dépistage est essentiel, car les consommateurs non dépendants sont généralement plus enclins à réduire ou à cesser leur consommation d’alcool avec un accompagnement adapté, contrairement aux personnes déjà dépendantes.
Les professionnels de santé peuvent intervenir à plusieurs niveaux :
Chez les patients avec une consommation à faible risque : l’objectif est de renforcer les comportements favorables à la santé (prévention primaire).
Chez les patients présentant une consommation problématique probable : une intervention brève, décrite dans cette fiche, permet de prévenir l’apparition de complications, de limiter les dommages liés à ce comportement et d’améliorer leur qualité de vie.
Chez les patients dépendants : une orientation vers une structure spécialisée en addictologie sera proposée.
Repérage précoce et intervention brève (RPIB)
Le RPIB est une démarche de prévention qui vise à identifier les comportements de consommation de substances psychoactives, en particulier l’alcool, et à encourager une diminution de ces consommations.
Ce dispositif s’adresse principalement aux personnes non dépendantes, tandis que les personnes dépendantes seront orientées vers des structures spécialisées.
Le RPIB se déroule en deux étapes principales :
repérage : il consiste à recueillir les informations sur les consommations déclarées et à évaluer les risques grâce à un questionnaire ;
intervention brève : elle se présente sous la forme d’un entretien motivationnel.
Son efficacité a été démontrée dans de nombreuses études.
Le repérage précoce a pour objectif de détecter les consommations à risque. Il repose sur un questionnement précis concernant le niveau de consommation, notamment en termes de quantité et de fréquence. Il est préférable d’utiliser des questions concrètes (par exemple : « Combien de verres d’alcool consommez-vous par semaine ? ») plutôt que des questions générales (« Buvez-vous de l’alcool ? »), souvent plus difficiles à interpréter.
Pour faciliter ce recueil, divers questionnaires sont disponibles selon les substances évaluées. Concernant l’alcool, deux outils particulièrement répandus sont :
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)
FACE (Fast Alcohol Consumption Evaluation)
AUDIT
Développé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le questionnaire AUDIT comprend 10 questions permettant d’évaluer les consommations déclarées au cours des 12 derniers mois. Il mesure la fréquence de consommation, la dépendance et les problèmes associés.
Un usage problématique est suspecté lorsque le score atteint :
- 7 ou plus chez les hommes
- 6 ou plus chez les femmes
Pour des scores supérieurs à 12, une dépendance est fortement suspectée.
Intervention brève
L’intervention brève vise à motiver un changement de comportement chez les consommateurs d’alcool à risques. Elle doit être proposée aux :
- Hommes avec un score de 7 à 12 au questionnaire AUDIT ou de 5 à 9 au questionnaire FACE.
- Femmes avec un score de 6 à 12 au questionnaire AUDIT ou de 4 à 9 au questionnaire FACE.
D'une durée variable de 5 à 20 minutes, l’intervention brève peut être unique ou répétée. Le but : informer, échanger, définir des objectifs atteignables avec le patient et orienter si besoin.
Professionnel de santé, vous souhaitez vous former sur le Repérage précoce et l'Intervention brève ? Rendez-vous ici
Pendant la grossesse
La question de la consommation d’alcool pendant la grossesse doit être abordée systématiquement avec chaque patiente. Il est préférable de le faire dès que possible, mais plusieurs moments se prêtent à cette discussion :
en consultation préconceptionnelle ;
lors de la déclaration de grossesse ;
au cours de l’entretien prénatal précoce ;
pendant une consultation de suivi ;
durant les séances de préparation à l’accouchement.
Bien que de nombreux questionnaires puissent être utilisés, ils ne remplacent pas le dialogue. Ils jouent cependant un rôle facilitateur en initiant et en enrichissant les échanges. Parmi ces outils, le test T-ACE est le plus fréquemment employé.
En dehors de la grossesse, les consultations gynécologiques et médicales offrent également l’occasion d’aborder la consommation d’alcool chez les femmes en âge de procréer. Comme pour le tabac, ces consultations permettent de dépister une éventuelle consommation et d’informer sur les risques pour la santé et la grossesse.