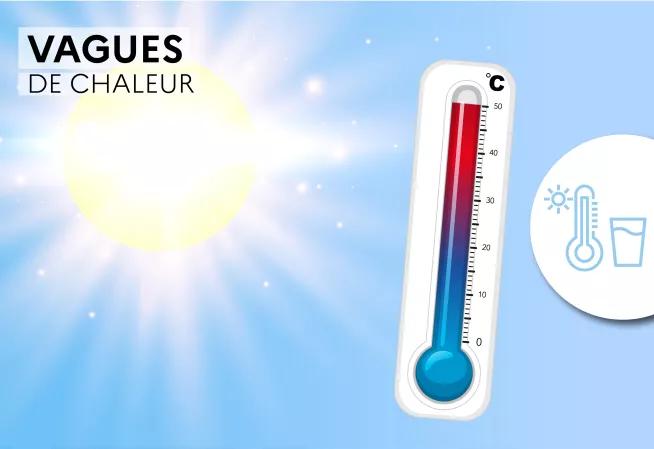En 2022, les consommations de substances psychoactives restaient très largement répandues chez les jeunes avec une phase d’expérimentation qui commence dès l’adolescence : 81 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté l’alcool et 30 % le cannabis. Durant cette période du passage de l’adolescence à l’âge adulte, les jeunes sont plus susceptibles d’expérimenter ou de consommer avec excès des substances psychoactives, notamment dans le but de renforcer les liens sociaux.
Source : Les drogues à 17 ans – Analyse de l’enquête ESCAPAD 2022. Tendances 155, OFDT. Mars 2023.
Ainsi, en concert, en festival ou pendant une fête entre amis, on se protège des risques liés à l'alcool, aux drogues et aux rapports sexuels non protégés :
L'alcool, en quantité raisonnable et raisonnée
Comment éviter la surconsommation ?
Quelques éléments permettent de repérer un état de sur-consommation (pour l’alcool ou d’autres produits) : forte désinhibition, personne titubant, visage pâle, nausées, somnolence, incohérence dans les propos, incoordination motrice…
Pour l'éviter, au quotidien, Santé Publique France indique des repères de consommation d'alcool pour limiter les risques sur sa santé :
• ne pas consommer plus de dix verres standard par semaine ;
• ne pas consommer plus de deux verres par jour ;
• avoir des jours sans consommation dans une semaine.

Les risques d'une surconsommation
Une consommation excessive d’alcool place la personne dans une situation de grande vulnérabilité, exposée à de nombreux risques. Les effets peuvent varier selon les individus, allant de simples nausées et somnolences à une perte de connaissance pouvant évoluer vers un coma éthylique.
Le coma éthylique correspond à une intoxication aiguë liée à l’absorption massive d’alcool sur une courte période. Il se manifeste par une altération progressive de la vigilance, marquée par des phases de confusion, d’agitation, puis un endormissement profond pouvant conduire à une perte totale de conscience.
Les dangers sont multiples : exposition accrue aux violences (vols, agressions sexuelles ou physiques), troubles de l’équilibre entraînant des chutes et des blessures (notamment des traumatismes crâniens), déshydratation sévère, hypothermie due à une chute rapide de la température corporelle, risques d’étouffement liés aux vomissements ou à un affaissement de la langue, et détresse respiratoire.
Lorsque l’alcool est combiné à d’autres substances, en particulier des dépresseurs (comme certains médicaments), le risque vital s’accroît : un arrêt respiratoire ou cardiaque peut survenir.
Au volant, je suis "Sam" ou je passe mon tour
Par ailleurs, l'alcool diminue les réflexes, la vigilance et multiplie par 8 le risque d'être responsable d'un accident mortel de voiture.
A plusieurs, on désigne un "Sam" : celui / celle qui conduit et qui ne boit pas pour ramener ses amis en vie après une soirée festive.
Et si tu es seul, avant de prendre le volant, on contrôle son niveau d’alcoolémie à l’aide d’un éthylotest : la limite fixée est de 0,5 g d’alcool par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d’air expiré. Pour les conducteurs titulaires d’un permis probatoire, et ceux en situation d’apprentissage, la limite fixée est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d’air expiré.
Drogues illicites : connaitre les risques
- Sur le cannabis : MILDECA | Cannabis : 20 messages pour comprendre les risques
Quels effets sur la santé ? L’usage du cannabis provoque un effet sur la mémoire et diminue la capacité à apprendre des choses nouvelles et à s’en souvenir. De plus, le cancer du poumon est plus précoce chez les consommateurs de cannabis. La fumée du cannabis contient plus de substances cancérigènes que celle du tabac : elle est donc toxique pour le système respiratoire et peut favoriser le cancer du poumon, comme de la gorge. Enfin, consommer du cannabis modifie le rythme cardiaque et peut être dangereux pour les personnes souffrant d’hypertension ou de maladie cardiovasculaire. En savoir plus
- Sur la cocaïne : MILDECA | Cocaïne : deux vidéos pour mieux connaitre les risques
Se protéger contre les IST et le VIH
VIH, hépatite B, hépatite C, chlamydia, papillomavirus, gonococcie, syphilis… les infections sexuellement transmissibles se transmettent lors de relations sexuelles non ou mal protégées.
Ainsi, pour s'en protéger :
- Utiliser un préservatif pour chaque rapport sexuel et avec chaque partenaire dont on ne connaît pas le statut en terme de contamination par le VIH ou les autres IST
- Tous les jeunes de moins de 26 ans peuvent obtenir des préservatifs gratuitement en pharmacie : en savoir plus
- Se faire dépister de manière régulière et en cas d'incident ou de prise de risque
- En savoir plus sur comment et où se faire dépister en Normandie grâce notamment au Dispositif "Mon Test IST"
- En cas d'exposition possible au VIH : rendez-vous le plus vite possible aux urgences d‘un hôpital ou dans un CeGIDD, idéalement dans les 4h après l’exposition et au plus tard 48h après l’exposition. En dehors des heures d’ouvertures des CeGIDD, rendez-vous dans les services d’urgences.
À noter qu'un traitement « post-exposition » est également possible concernant le risque de transmission de l’hépatite B.
Pour éviter une grossesse non désirée
- Utiliser un moyen de contraception adapté à vos besoins : Comment choisir sa contraception ?
- En cas de rapport non protégé ou mal protégé, il existe une contraception d'urgence médicamenteuse (moins efficace qu'une méthode régulière)
- Disponible en pharmacie, sans prescription médicale et sans avance de frais pour toute personne mineure ou majeure : en savoir plus
- En dernier recours, l'interruption volontaire de grossesse (IVG): en savoir plus