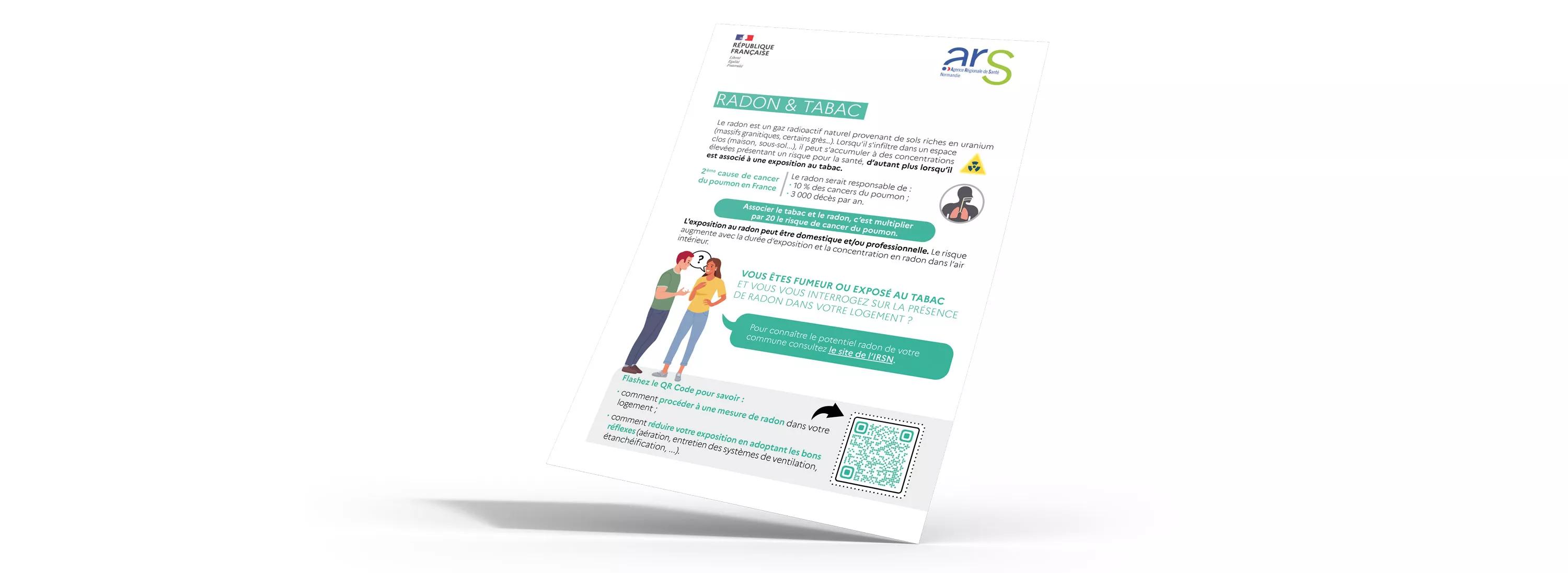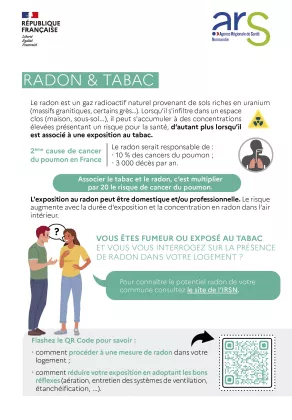Le radon se diffuse dans l’air à partir du sol, directement au travers des couches géologiques et pédologiques. Sa diffusion vers la surface est favorisée par la présence de failles. A l’air libre, sa concentration est faible. A l’intérieur des bâtiments, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées en l’absence de bonnes conditions de ventilation. Sa concentration dépend donc des facteurs géologiques, mais aussi de la conception et des équipements des bâtiments et des modes de vie (notamment en matière d’aération).
Le radon est reconnu comme cancérogène pulmonaire depuis 1987 par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer). À long terme, l’inhalation de radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est proportionnelle à l’exposition cumulée tout au long de sa vie.
Le lien entre exposition au radon et cancer du poumon a été en premier lieu démontré par des études menées sur des mineurs exposés, sous terre, à de fortes concentrations en radon.
Par ailleurs, si l’usage du tabac est responsable de la majorité des cancers du poumon, l’exposition simultanée au radon et au tabac augmente de façon significative le risque.
Selon l’OMS, le radon est le deuxième facteur de risque du cancer pulmonaire (derrière le tabac) Le nombre annuel de décès par cancer du poumon lié à l'exposition domestique au radon est estimé à environ 3 000 en France. Il est, dans les habitations, la principale source d'exposition à des rayonnements ionisants ce qui, dans de nombreux pays, représente 50 % de l'exposition des populations à la radioactivité naturelle. Pourtant, le public n'est guère sensibilisé à ce risque bien que des mesures relativement simples permettent de limiter son exposition.
Sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, un niveau de référence à 300 Bq/m³ en moyenne annuelle a été retenu en dessous duquel il convient de se situer.
Le risque étant d’autant plus faible que la concentration est basse, il est, de manière générale, pertinent de chercher à réduire les concentrations en radon aussi bas que possible quel que soit le niveau mesuré.
Pour en savoir plus sur le radon, son origine et les effets sur la santé : site de l'ASNR.
Sur son site internet, l'ASNR propose une rubrique consacrée au radon avec notamment une carte interactive pour connaître le potentiel radon de sa commune. Consultez la rubrique radon du site de l'ASNR
Cette cartographie a été reprise dans l’Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/27/SSAP1817819A/jo/texte
La réglementation sur la surveillance des concentrations en radon dans certains établissements recevant du public a été modifiée par le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018, transposant la directive européenne du 5 décembre 2013.
Cette règlementation fixe des obligations de surveillance des concentrations en radon tous les 10 ans dans certaines catégories d’établissements recevant du public situés sur des zones à risque établies par l'ASNR ( du fait de la nature géologique des terrains).

Les établissements concernés par l'obligation de surveillance sont les établissements :
D'enseignement (y compris les internats) ;
d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans ;
sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec hébergement ;
pénitentiaires ;
thermaux ;
Ces derniers sont soumis à cette surveillance s'ils sont situés sur une collectivité classée en potentiel radon significatif (zone 3), ou si des mesures avec des résultats supérieurs ou égaux au niveau de référence (de 300 Bq/m3) y ont été réalisées et ce, quelle que soit la zone où ils se situent.
Mesures
Les mesures doivent être réalisées à la demande du propriétaire ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant, par un organisme agréé, par l’ASNR.
Celles-ci sont à renouveler tous les 10 ans suivant la réception des résultats de la dernière campagne ou après la réalisation de travaux modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment.
Actions correctives
En cas de dépassement de la valeur de référence de 300 Bq/m3, le propriétaire ou l’exploitant doit mettre en œuvre des actions correctives visant à améliorer l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points de pénétration du radon dans les locaux et améliorer le renouvellement de l’air. En cas de persistance de concentrations élevées, ou en cas de résultats initiaux supérieurs à 1000 Bq/m3, une expertise du bâtiment devra être réalisée suivie de la mise en œuvre des travaux afin d’abaisser les concentrations de radon en dessous du niveau de référence, comme précisé dans l’arrêté du 26 février 2019.
Le propriétaire ou l’exploitant doit réaliser ces actions dans un délai de 36 mois à la réception des résultats de la campagne de mesures. Il doit également procéder à un affichage des résultats de mesure du radon dans un délai d’un mois suivant la réception du dernier rapport d’intervention.
Les éléments de présentation de cette réglementation sont rappelées dans la présentation faites à l’occasion de forums sur le radon (cf Actions de sensibilisation au risque radon : FORUM RADON - Juin2019 - 2 - Réglementation ERP (pdf, 767.17 Ko)
Actions de sensibilisation
Différents forums et webinaires ont été organisés pour sensibiliser les collectivités et les établissements aux enjeux liés au radon et à la qualité de l’air intérieur, notamment dans un contexte de rénovation énergétique :
- webinaire CNFPT / ARS / CEREMA – « Qualité de l'air intérieur (QAI) et radon : des enjeux de santé publique dans un contexte de rénovation énergétique » - 23 septembre 2025 – REPLAY
Le 11 février 2021, la DREAL et l’ARS Normandie ont organisé un webinaire à l’attention des collectivités locales sur la qualité de l’air intérieur et le radon. Ce webinaire, qui comptait 162 inscrits, avait pour objectif de fournir aux participants une vue d’ensemble des enjeux réglementaires et techniques ainsi que des retours d’expérience de bonnes pratiques locales.
Pour les consulter, cliquez-ici
Deux demi-journées d’information pour les collectivités et établissements situés sur les zones à risque radon significatif dans notre région ont eu lieu le 11 juin 2019 à Vire et le 12 juin 2019 à Cherbourg en Cotentin.
Pour consulter les supports, cliquez-ici
Réglementation
Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 (potentiel significatif), les vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers doivent informer les acquéreurs ou locataires de l’existence de ce risque.
Cette information est reprise dans le modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques, ainsi qu'une fiche d’information sur le radon (disponibles sur le site www.georisques.gouv.fr). Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, doit être annexé au contrat de vente ou de location d'un bien immobiliers.
Cette obligation d’information n’est pas assortie d’une obligation de mesure.
Comment mesurer la concentration en radon dans son logement ?
Les occupants sont encouragés à procéder à une mesure, qui est le seul moyen de connaitre la concentration en radon dans son logement. Pour cela, des détecteurs (dosimètres radon) disponibles sur Internet peuvent être placés dans son logement dans les pièces les plus régulièrement occupées, sur une durée 2 mois ou plus et de préférence pendant une période de chauffage (saison hivernale).
La liste des fournisseurs est disponible sur la page de l’ASNR.
Actions locales de sensibilisation
A l’initiative de collectivités ou d’associations, et avec le soutien de l’ARS, des actions locales de sensibilisation du public au radon dans l’habitat peuvent être lancées sur les zones les plus susceptibles d’être exposées.
Pour déployer ces actions (méthodologie présentée dans le flyer « Déploiement d’une action locale »), différents outils ont été élaborés et sont mis à disposition des partenaires boite à outils régionale avec notamment une plaquette de sensibilisation : Le radon et la qualité de l'air intérieur dans mon logement - nov. 2021 (pdf, 1.3 Mo)
Des outils nationaux sont également consultables (boite à outils nationale et guide national de l’ASNR sur le rôle des collectivités dans la mise en œuvre de ces actions et les aides mobilisables).
Les collectivités intéressées pour engager ces actions peuvent se rapprocher du Pôle santé environnement de l’ARS (ars-normandie-sante-environnement@ars.sante.fr).
Limiter l'exposition
Dès lors que la présence en radon est avérée par la mesure, deux types d’action permettent de réduire sa concentration :
- limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures et des passages de canalisations à l’aide de colle ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte d’une dalle en béton, etc…) ;
- diluer le radon présent en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de l’aération naturelle ou mise en place d’une ventilation mécanique adaptée).
Selon les niveaux de radon mesurés, les solutions les plus efficaces peuvent nécessiter de combiner les deux types d’actions. Au-delà de 1000 Bq/m3, il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel.
L’efficacité des travaux de réduction doit être vérifiée en effectuant de nouvelles mesures de concentration en radon.
En matière de rénovation, ou de construction neuve, il est également possible de prévenir l’accumulation de radon dans les logements par la mise en œuvre de techniques :
- étanchéité des sous-sols, vides sanitaires, murs et planchers, et des passages de canalisations ;
- ventilation des vides sanitaires,
- mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée.
Pour plus de précisions sur les actions de remédiation : Retrouvez l'intégralité du site du CSTB ASNR
ARS |
L'association du tabac et du radon augmente significativement le risque de développer un cancer du poumon : le risque est multiplié par 20.
Pour prévenir de ces risques, l'ARS Normandie a créé une fiche pratique pour informer les usagers des dangers encourus.
Consulter la fiche pratique en cliquant ici